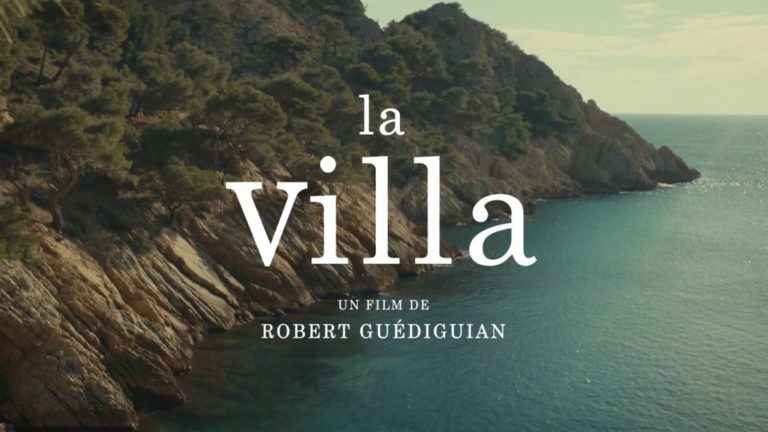Le premier mot du film est prononcé par Fred Ulysse : « tant pis » ; il le dit, et il s’écroule. Théâtral, non ? C’est le père ; il regarde la méditerranée en hiver et hop ! Syncope. La messe est dite ? Tout de suite, on sait que la vidéo promotionnelle sur les calanques, il va éviter, notre Guédiguian : l’image est pâle, les couleurs presque revêches, l’architecture filmée dans ce qu’elle a de bricolé et de plutôt décati (l’impression d’érosion et de décrépitude que peut donner Marseille parfois). Le père ne meurt pas de cette « attaque », mais il reste – paralysé, et on ne sait pas à quel point il est là.
Il va mourir, mais il n’est pas encore mort ; on vous le dit et on vous le répète : « ça peut durer », et on ignore à quel point il est encore vivant… Emblème ! Il n’a plus rien à dire ? Est-ce qu’il entend ? Et nous, où sommes-nous ? Est-ce que quelque chose nous fige ? Qu’est-ce qui reste vivant ? Et sommes-nous là ? Sommes-nous là où nous sommes ? Qu’est-ce que vivre, qu’est-ce qu’être vivant ? Zéro grandiloquence, pas de réponses… juste des faits ? Oui, les conversations aussi en sont, non ? Quand aucune parole n’est acquise et que se manifeste là une micro-culture du conflit.
Convergence autour du fauteuil dans un environnement peu propice à rouler, où tout est escarpements et escaliers : arrive la sœur – Ariane Ascaride – qui était partie sans retour depuis 20 ans (s’absenter ailleurs, c’est ce qu’elle confessera peu à peu) ; elle est regardée du balcon par le frère – Jean-Pierre Darroussin – parti / revenu (de tout), mais avec une jeunette – Anaïs Demoustier, qui conduit une Mercos et parle beaucoup d’argent ; l’autre frère – Gérard Meylan – est resté, et aussi resté seul, apparemment. Aucun de cette fratrie ne semble avoir d’enfant. Il y a eu une petite Blanche, mais elle s’est noyée en voulant rattraper son doudou. Alors il est où, le paradis perdu, avant la catastrophe ? Ou dans les souvenirs [Au passage, pour ceux qui se demandent comment Guédiguian a fait, à propos de cette séquence de la jeunesse joyeuse, et bien, c’est simple : c’est un extrait de Ki lo sa, avec les mêmes acteurs.] autour de cette villa bâtie en commun, entre les voisins d’utopie, dans ces hameaux de mutualité élective des calanques, comme entre ces artistes qui ont cherché ensemble, nous ont enchantés souvent ?
Une enfant est née, une enfant est morte. Emblème. Est-ce que sa vie a moins de sens parce qu’elle fut brève ? Y a-t-il un âge pour mourir ? Existe-t-il une durée validante ? Oh, ces présences en creux… Est-ce que la petite vie qui n’a pas pu croître est la racine du refus de la vie, le refus de l’enracinement et de la croissance de l’utopie, son défaut d’incarnation ?
Il voulait quelque chose, cet homme à présent muet, terrassé dans son fauteuil (mais vêtu d’une chemise rouge sang, sublime, on est à Marseille, tout de même ! C’est une des villes du monde où l’on croise les hommes du peuple avec les plus belles chemises !), il végète sur son modeste chef-d’oeuvre, devant l’eau qui s’élargit de là. Il drainait un espoir. Il avait un sens du partage, du faire ensemble. Il menait l’organisation de vrais Noël de transcendance des séparations ; il voyait grand ! les sapins, c’est un début. C’était un temps où l’on y croyait, au père… Noël ? À l’abondance pour tous ? Mais il n’a pas pu protéger ce lieu où il voulait, ce père, que s’élève une commune (c’est l’origine du mot communiste, rappelle Darroussin). Ce possible n’est pas advenu. Ils ont construit ensemble : une villa. Ceux qui ont aidé à la bâtir et n’étaient pas propriétaires ne pourront pas faire face par leurs propres moyens à l’augmentation de leur loyer. Ils sont demeurés locataires et les descendants des propriétaires du cabanon n’ont pas pu respecter la parole donnée par leurs parents. Ces compagnons des calanques (Geneviève Mnich et le colossal Jacques Boudet) ne veulent pas de l’aide de leur fils (Yann Trégouët) devenu médecin laborantin, qui a grandi là, lui aussi et n’en manque pas, d’argent… Pourquoi survivre à leur monde, puisque leur monde est mort ? Ils optent tranquillement pour le suicide. La scène des adieux au vieux camarade est l’une des plus belles, des plus légères, des plus drôles. Doit-on survivre à ses rêves, à ses valeurs, à sa vision du temps à venir ?
Est-ce que mourir affranchit ? Qui ? Ceux qui s’en vont, ou ceux qui peuvent alors ne pas rester (le fils, qui va partir à Londres ; j’ai entendu parler d’impôts, ou j’ai projeté ? Ben, quoi, au ciné, ça se fait !). Jusqu’où, la liberté ? Le choix de la mort est-il le fruit d’une crispation, d’une rigidité, d’un manque d’imagination ? Le résultat d’une pensée arrêtée ? Qu’est-ce qui a été transmis ? Où est la fécondité ? Deux des jeunes vont partir à Londres ? Ils sont à l’aise avec l’argent. Quel monde feront-ils ? Un autre (Robinson Stévenin) vit là et de sa modeste pêche ; il connaît Claudel par cœur (pourquoi, Claudel ? Tu te moques, là, Robert !!! t’aurais pas pu trouver autre chose ? Ben si, t’aurais pu ! Alors quoi ? Tu deviens mystique ? Tu réintroduis dieu incognito ? Allez, je te pardonne, va ! On ne dira rien à Camille). Qu’est-ce qu’on incarne, au théâtre, au cinéma, sur la terre, c’est bien ta question, mon Bob ?
Enfin ce pauvre pêcheur maintenant et à l’heure de notre mort, ce magnifique Stévenin nouvelle génération (ben, oui, tout ne saurait se passer à l’écran, il y a aussi des récits méta-filmiques, des choses qu’un au-delà de l’image racontent), ce Stévenin-là, donc, apprend par cœur des textes et s’en va une fois par semaine partager le théâtre dans les « cités » (disait-on, quand c’était mon temps d’y vivre, aujourd’hui, on dit les « quartiers », comme si autrefois la cité se concentrait dans ces lieux de la ville désertés par l’argent, et qu’aujourd’hui, la ville riche ne faisait pas de quartiers, seulement la pauvre…). Il sait, ce jeune pêcheur miraculeux, où et quand il est né à autre chose, à d’autres épaisseurs du réel… que c’est au théâtre qu’il a appris qu’on pouvait cesser pendant une heure de se prendre pour soi. Se déprendre de soi, c’est le bénéfice de l’art ? oui, on peut le voir comme ça… mais alors ce soi serait celui qui s’est empêtré dans certaines réalités si peu réelles ? je penserais de préférence que là où l’art m’enthousiasme, je suis vraiment ; que mon âme (la part essentielle de mon être au monde, ma quintessence) trouve asile dans l’art qui m’enthousiasme, que cet enthousiasme est l’indice de la vitalité subreptice de mon âme et de sa « sousvivance » (écrit génialement Marie-Hélène Lafon, dans Nos vies). Alors, mon Bobby : c’est au sein de l’art amateur partagé que la vie peut se réfugier ? Oui, je serais assez d’accord ! Camus en parlait comme ça, oui ? Et Barthes aussi, qui comparait les ateliers d’écriture à des phalanstères… Notre esprit accueilli en partage dans ces marges, quand bien des vies sont perdues à si peu la gagner…
Foin de l’orgueil de la classe populaire ! foin de la lutte des classes ? C’est mort ? Tant pis ? La révolution n’a pas eu lieu ? Il ne reste que cette infime aspiration à en être tel qu’en soi-même, de ce monde, Robinson éberlué sauvé du si peu pacifique et qui cherche ses frères humains : ceux que la vie lui proposait depuis le début, ou les nouveaux naufragés du siècle, ceux qu’on pourrait soustraire un moment à l’absurdité, juste un moment, qu’ils fassent halte, qu’ils reprennent leur souffle, qu’ils se reposent avant de replonger dans la grande soupe de l’atroce revival… pas d’incitation à la résistance civile ? Juste un minimum, quand même ! Essayons au moins de savoir ce qui leur arrive à nos interdits de séjour… Des migrants ? Comme si chacun ne cherchait pas au passage l’espace où vivre, le terroir propice, l’anse moins malaisante ! sinon ? ce n’est plus l’heure de donner des leçons, de chapitrer le bonheur de masse, d’entraîner au trek pour le paradis.
On n’a rien sauvé ? Depuis les tranchées, on rêvait de tuer la guerre, d’éradiquer la pauvreté, de laisser émerger tous les hymnes à l’amour, de protéger la santé, de prendre le temps de vivre, de mettre nos luttes à ce service : ne pas crever bêtement… revenons au minimum : les mini-mômes ? les fraternités de relais ? les amours transitoires ? La villa ? N’était-ce pas l’unité première de la république, dans l’antiquité ? Pour nos barbares magnifiques, en demande d’asile, nous ne connaissons qu’un seul mot : « choukrane ». Merci, Robert, ça fait du bien, une halte dans tes images. Rendons grâce à la vie, oui ! Et « bienvenue », comment ça se dit ? Robert, on sait bien que c’est encore ce que tu rêverais de dire : « bienvenue ». Allez, viens, frère, je vais te faire un café !